Foutue bergerie
création en septembre 25 au théâtre de Cornouaille à Quimper
Texte et mise en scène
Pierre Guillois
Comédien·nes Cristiana Reali, Marc Bodnar, Anna Fournier, Lucie Gallo, Simon Jacquard, Kevin Perrot, Yanis Chikhaoui
Assistante à la mise en scène
Lorraine Kerlo Aurégan
Scénographie Camille Riquier
Costumes Axel Aust, assisté de Camille Pénager
Lumières Jérémie Papin
Décor Ateliers de construction de la maison de la culture de Bourges
Administration générale Sophie Perret
Chargée d’administration Fanny Landemaine
Direction technique Colin Plancher
Responsable de production Marie Chénard
crédit photo : Arnaud DESPLECHAIN





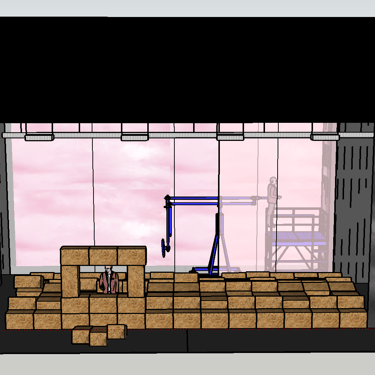
Une ferme à la lisière de la ville. Des moutons causeurs et qui se rêvent philosophes. Un fantôme, celui du fils pendu dans la grange et qui hante la mémoire des parents dévastés. Un frère en conflit avec ce mort, en conflit avec le monde. Un jeune stagiaire maghrébin comme un agneau parmi les loups. Des pitbulls qui déchiquètent des moutons, pour de vrai. Une pigiste aux dents longues qui veut en découdre avec le groupe chimique responsable du drame familial…
Quelques cauchemars plus tard peuplés de cadavres en tous genres et de policiers passifs, et après quelques parties de fesses dans le foin, les champs bientôt destinés à devenir des lotissements racontent une France aux abois, entre deux mondes, qui se frotte avec ambivalence aux turpitudes du siècle.
« Inviter la campagne à se faire une place dans le théâtre, chargée de problématiques qui enjambent l’aspect social ou environnemental strictement rural.



Le voleur d'animaux
création en sept 2021 à scène des Vosges
Ecriture, jeu et dessins Hervé Walbecq
Mise en scène Pierre Guillois
Scénographie Camille Riquier
Dramaturgie Laure Hamidi
Administration générale Sophie Perret
Chargée d’administration Fanny Landemaine
Chargées de production Margaux du Pontavice Louise Devinck
Le voleur d’animaux est le récit autobiographique d’un cancre au milieu d’une fratrie de cancres allant de petites bêtises de collégiens jusqu’à la fabrication d’une bombe. Ce texte raconte aussi le lien très particulier qu’avait l’auteur aux animaux à cette époque-là et qu’il a d’ailleurs conservé.
A l’adolescence, après avoir vécu pendant plusieurs années avec un oiseau en liberté dans sa chambre, beaucoup d’autres animaux sont entrés dans sa vie. Au fil des jours, il a développé avec eux une relation très intime, presque mystique. Plus le contexte scolaire est devenu difficile, plus le cancre qu’il était s’est lié, s’est identifié à eux.
Au-delà de l’animal, ce texte raconte aussi la découverte salvatrice du théâtre, de la poésie, et décrit le monde absurde que ses frères et lui se sont inventés, pour survivre, pour échapper. Comment, face à la violence d’un système, un adolescent peut en quelque sorte s’absenter du monde, vivre ailleurs, disparaître, à tel point que le jour où la bombe explose véritablement, il ne s’en aperçoit même pas.










Sa bouche ne connaît pas de dimanche
création en mars 2021 au Quartz, scène nationale de Brest
Conception et interprêtation : Rébecca Chaillon et Pierre Guillois
Création lumière Suzanne Péchenart
Création sonore Elisa Monteil
Scénographie Camille Riquier
Régie générale et lumière Suzanne Péchenart
Régie plateau Elvire Tapie
Diffusion Séverine ANDRE-LIEBAUT
Administration Sophie Perret
Chargée d’administration Fanny Landemaine
Chargées de production Margaux du Pontavice
Louise Devinck
crédit photo Margot Dejeux
Sans doute l'histoire d'une noire et d'un blanc, d'un pédé et d'une gouine, d'une bavarde et d'un taiseux qui taillent une bavette, de saint Pierre et de la Vierge Noire, d'une bouchère et d'un idiot, d'une croyante et d'un crédule. Il y aura des joutes verbales, des listes et à lire entre les lignes.
Au départ, ils se sont amusés à coécrire leurs parcours respectifs. À l’origine de Rébecca, la Martinique. À l’origine de Pierre, la Bretagne. Mais Rébecca prend conscience qu’elle est noire et Pierre, qu’il est homosexuel. Dépliant les couches de la genèse de leurs personnes, ils dénudent leur rapport ambigu au catholicisme, au sacré, à la pureté. La chair vient tout naturellement souder ces questionnements, celle de l’animal, celle que l’on mange, celle qui cristallise le paradoxe entre plaisir du goût du sang et sentiment de culpabilité de la tuerie nourricière. Créatures divines et personnages profanes, les deux artistes invoquent aussi la société dont ils rêvent.
